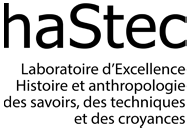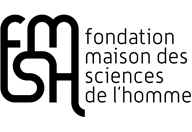1.
Le 27 octobre 1885, Alexandre Yersin, âgé de vingt-deux ans, arrivait à Paris pour étudier la médecine ; une décennie plus tard, il était connu partout dans le monde pour avoir découvert le bacille de la peste (Yersinia pestis) 1.
typologie des savoirsdisciplinessciences formelles et expérimentalessciences de la vie et de l'environnementsciences de la vie par type d'organismesbactériologie espaces savantslieulaboratoire matérialité des savoirssupportsupport d'inscriptioncarnet pratiques savantespratique intellectuelleobservation Yersin s’était embarqué pour un « grand voyage d’exploration » : il passa les premiers mois de son séjour à faire la navette entre l’hôpital, le matin, et les rues de Paris, dans l’après-midi, voire à pénétrer dans les logis des pauvres et dans les repaires des gamins des rues, à observer et à consigner ses observations dans les centaines de pages de ce « journal » par lettre qu’il envoyait deux fois par semaine à sa mère2. Puis, une fois qu’il eut intégré le laboratoire de Louis Pasteur, ce type de comportement fut à l’origine de la première enquête microbiologique qui fût menée sur des populations humaines et il en fournit la structure. Qui plus est, la cohue urbaine devait par là même cesser d’être l’antithèse inconnue et chaotique du cadre strictement contrôlé du laboratoire et de la clinique. Elle devint ainsi un espace de connaissance bactériologique et épidémiologique à part entière. Enfin, la bactériologie donna naissance à une forme fondamentalement mobile de science et de techniques de laboratoire.
acteurs de savoircorpssanté typologie des savoirsdisciplinessciences formelles et expérimentalessciences de la vie et de l'environnementmicrobiologie matérialité des savoirsinstrumentinstrument d'observationmicroscope construction des savoirsvalidationexpérimentationCe n’est ni la discipline qu’il avait choisi d’étudier ni sa formation qui inspira à Yersin cette activité d’observation errante. Mais si elle fait de lui un cas unique en son genre parmi les médecins et bactériologues de son temps, elle ne le singularise cependant pas par rapport au Paris de l’époque en général ; peintres, romanciers, journalistes, détectives privés et enquêteurs en sciences sociales déambulaient dans les rues et dans les demeures de la ville, pour observer, analyser, dépeindre. Ces gens, pourtant, s’inscrivaient dans des mouvements ou dans des traditions artistiques et scientifiques ; Yersin non. Et s’il développa et promut une méthode, il ne le fit pas consciemment, contrairement à eux. Sa pratique de chercheur n’est pas non plus un héritage des traditions de l’investigation médicosociale et épidémiologique ou de la police sanitaire et médicale3.

acteurs de savoirstatutoisif acteurs de savoirmodes d’interactioncollaborationL’histoire de Yersin nous permet d’entrer dans l’histoire culturelle d’une science expérimentale et des pratiques de laboratoire. Son étude au microscope des infections de la ville s’inscrit dans un chapitre plus large de l’élaboration de la microbiologie médicale et implique Émile Roux, le principal collaborateur de Pasteur, qui engagea le jeune étudiant en médecine et le prit comme assistant. La thèse que je voudrais défendre ici est qu’ils transformèrent en science des formes de vie urbaine et la relation entre la ville et la « campagne ». Yersin mit au point sa pratique de chercheur à partir de ses activités de loisir : flâner, lire des romans, et même aller à la mer, comme les habitants de la ville se mirent à le faire à l’époque. Il étendit la bactériologie de terrain en dehors des limites de la ville en prenant très exactement les routes suivies par ces excursions. Quant à Roux, il conçut ses méthodes de laboratoire, son analyse des données et la manière d’expliquer les maladies qu’il devait ensuite enseigner à l’Institut Pasteur, à travers ce que Yersin appelle son « genre de vie » et en particulier l’expérience qu’il fit des modifications de sa santé selon qu’il vivait en ville ou à la campagne.
Les investigations urbaines de Yersin faisaient partie d’un projet qu’il avait persuadé Roux d’entreprendre autour de la diphtérie, une maladie courante redoutable qui frappait les enfants dans les villes d’Europe et d’Amérique du Nord à la fin du xix e siècle. La diphtérie donna à Roux la possibilité d’explorer une hypothèse générale qu’il avait formulée, avec Pasteur, dans leurs études sur l’anthrax en 1881 : le fait que les maladies infectieuses ne résultent pas seulement de la contagion, mais aussi et peut-être surtout de l’activation de microbes latents (« atténués ») toujours présents dans les corps des hommes et des animaux. Ainsi les épidémies étaient-elles moins des invasions que des perturbations d’un équilibre fragile entre les microbes et la vie animale. Cette hypothèse était seulement une extrapolation à la nature en général des expériences de laboratoire que Pasteur avait consacrées à la virulence des microorganismes, qui était amenée à changer pendant le développement et la production de vaccins4. Ils n’avaient aucune preuve de « terrain ».
pratiques savantespratique discursivedescriptionPassons à la diphtérie : à partir de leur étude de gorges d’enfants, les savants ont décrit dans les années 1880 une forme bactérienne semblable en tout point au bacille diphtérique de Friedrich Loeffler, mais non pathogène pour les humains ou les animaux de laboratoire. Loeffler, un étudiant de Robert Koch, l’a surnommé le bacille pseudodiphtérique, et l’a traité comme une espèce séparée, sans aucun rapport avec la maladie. Mais l’était-il vraiment ? En mai 1889, Yersin a commencé à examiner les gorges et les bouches de douzaines d’enfants « normaux » (c’est-à-dire atteints d’autres affections, comme des insolations ou des cancers) à l’hôpital des Enfants malades, où il était interne. Il trouva ledit bacille pseudodiphtérique chez un tiers d’entre eux5. Mais qu’en était-il des enfants qui avaient déjà eu la maladie ?

1.1. Art et science de « plein air »
espaces savantsterritoireville espaces savantscirculationmobilité« Je suis en ville des enfants guéris et sortis de l’hôpital », nota Yersin dans son journal épistolaire à la date du 23 juin 1889. Il continua cette activité pendant toute la semaine et, par intermittence, pendant les six mois suivants. Il arpenta la ville avec ses éprouvettes, visitant et revisitant des enfants des classes laborieuses et des appartements de la petite bourgeoisie – par exemple Philippe Recoussines, huit ans, le fils d’un marchand de vin du IXe arrondissement – retournant avec des prélèvements de leur gorge au laboratoire où il les mettait en culture, les examinait au microscope et testait leur virulence sur des cochons d’Inde6. Faut-il interpréter ces parcours uniquement sur le modèle de la visite à domicile du docteur ? Le rôle médical était très certainement nécessaire, car il permettait à Yersin de faire des prélèvements sur le corps des gens. Mais cela n’aurait pas suffi. Les visites à domicile relevaient de la clientèle privée, et non pas de la pratique hospitalière. Qui plus est, étendre l’examen invasif et examiner tout un éventail de personnes, du malade au bien portant, ne faisait normalement pas partie des attributions du médecin. Dans le manuel Clinique de l’hôpital des Enfants malades de 1884, le médecin-chef concluait ainsi une longue présentation d’un cas important : « L’enfant est enfin sortie de l’hôpital, et l’observation est complète7. » Il était normal que l’espace de l’observation médicale et l’espace de l’hôpital se recouvrent parfaitement.
acteurs de savoirstatutmaître matérialité des savoirssupportsupport d'inscriptioncarnetLe mentor de Yersin, Roux, avait donné un nom à la bactériologie de terrain, à la bactériologie hors laboratoire. Il l’appelait « bactériologie en plein air !8 ». Le plein air était à ce point devenu un topos, une manière d’exprimer la vie et la pratique artistique, sociale et scientifique sous la IIIe République, qu’un des premiers manuels de l’enquête sociale urbaine, Les Enquêtes : pratique et théorie, de Pierre Du Maroussem (il fut publié dans une collection de sciences sociales à laquelle le pasteurien Émile Duclaux, le mentor de Roux, était associé) opposait « l’école allemande » à « l’école française » dans les termes suivants : « D’un côté, c’est la vie d’archives ; d’un autre c’est la vie d’activité et de “plein air” – un peu celle du “reporter” et du “détective”9. » En un mot, le Paris de Yersin était le Paris de l’art et de la science du plein air, celui de l’observateur mobile et solitaire, parcourant la ville, le peintre avec ses pinceaux, l’enquêteur social ou le romancier avec ses carnets, le bactériologiste avec ses éprouvettes. L’atelier, la bibliothèque, le bureau de la mairie, le cabinet de l’écrivain, le laboratoire et la clinique – étaient absolument nécessaires à la pratique artistique et scientifique, mais leurs murs devaient être percés. C’est à cette condition qu’on avait accès à la vérité du plein air.

construction des savoirspolitique des savoirsespace publicLe Paris des années 1820 et 1830 avait connu un boom économique, et la vie quotidienne de la bourgeoisie se transforma : on passa de l’intérieur de la maison à de nouvelles enclaves semi-publiques vouées aux spectacles, au loisir et à la consommation – les cafés, les dancings, les théâtres et les galeries marchandes (les passages). Vers 1840, il était très à la mode de flâner dans les passages à une allure de tortue, c’est-à-dire littéralement en suivant une tortue tenue en laisse10. Des caricatures représentaient un personnage en train de marcher d’un pas nonchalant, parfois immobile, toujours plein de suffisance, mais assez intrigué par ceux qui sont autour de lui pour porter des jumelles11. Au moment même où l’impressionniste Gustave Caillebotte se peignait lui-même en pied avec un haut-de-forme sur le nouveau pont de l’Europe en 1876, le flâneur s’était pourtant métamorphosé, devenant un observateur caractérisé par la rapidité de ses déplacements dans un paysage urbain géométrique, produit de l’haussmannisation, fait de poutres métalliques et d’espaces grands ouverts12.
acteurs de savoirsexe et genremasculinComme ces personnages, Yersin était par excellence l’observateur masculin à pied : son haut-de-forme signalant sa classe sociale et son indépendance le distinguait du petit-bourgeois reconnaissable à son chapeau ou du travailleur à sa casquette ; le mélange de distraction et de préoccupation qui marquait sa démarche le distinguait du pur piéton en affaires ou du banlieusard ; son œil vagabond, à la fois intelligent et observateur, et l’activité de son stylo le distinguaient du pur fainéant ou du badaud ; enfin, il marchait en solitaire, détaché de tout lien social ou domestique, différent en cela des couples ou des familles en promenade13.
En octobre 1885, quelque dix jours avant que le jeune Suisse ne fît ses premiers pas à Paris, il se trouva qu’un jeune Viennois arrivait également à Paris pour étudier en clinique. Sigmund Freud était fasciné par la capitale de la France, mais la vie des rues lui inspirait un sentiment de dégoût : « Les femmes, comme les hommes, se pressent autour des nudités comme autour des cadavres de la Morgue ou des horribles affiches dans les rues », annonçant les derniers romans14. Yersin au contraire vint tout exprès visiter la morgue. Cet étudiant en médecine, partagé entre son faible pour les spectacles et son amour pour son atlas d’anatomie, ne dédaignait pas de décrire la beauté d’un pied amputé qu’il était chargé de disséquer ; il visita deux fois la morgue pour voir les corps exposés dans leurs boîtes de verre, mais également pour faire l’expérience de la foule qui s’y pressait et la regarder comme un spectacle15. Alors que Freud regardait d’un œil strict et distant les foules parisiennes qui lui inspiraient ses premières réflexions sur les « épidémies » psychiques et la psychologie des masses16, Yersin, quant à lui, s’y plongeait littéralement, une expérience qui a animé bien des écrits de Baudelaire et qu’il identifiait avec l’observation de la vie moderne17.
construction des savoirsépistémologieméthode typologie des savoirsdisciplinessciences formelles et expérimentalessciences de la vie et de l'environnementsciences de la vie par type d'organismesbactériologieOn mesure d’autant mieux à quel point la bactériologie de terrain de Yersin trouve ses origines dans la vie de la rue et combien elle en adopte le style quand on la compare à des pratiques mises en place dans d’autres villes. Quelques années plus tard, le bactériologiste de la ville de New York, William Park, lança à son tour une enquête sur les infections urbaines propres à Manhattan. Comme Yersin, Park venait juste de terminer ses études de médecine et s’était spécialisé en bactériologie, et comme lui, il utilisa ses connaissances pour enquêter sur les signes cliniques de la diphtérie18. Le protocole qu’il mit en place pour évaluer l’infection diphtérique en ville était de style aussi new-yorkais que la démarche de Yersin était parisienne.

espaces savantsterritoireville construction des savoirspolitique des savoirsgestionplanificationPour assurer une meilleure efficacité du commerce, des transports et du contrôle, les ingénieurs conçurent le plan de Manhattan comme une grille, un modèle que les ingénieurs de Haussmann rejetèrent expressément ; il ne convenait ni à l’embellissement ni aux promenades 19. Le modernisme avancé du xx e siècle, en matière architecturale et en planification urbaine, allait placer au centre de ses concepts le quadrillage et ses vertus supposées, qui étaient cependant aussi anciens que les forteresses romaines. Comme le Paris produit par l’haussmannisation avait encouragé le bactériologiste, après l’écrivain et le peintre, à abandonner son lieu de travail traditionnel et à poursuivre son activité professionnelle en l’intégrant à son temps de loisir et à l’espace de la ville, la grille de Manhattan et sa philosophie économique devaient inspirer au bactériologiste le système spatial régulier qu’il créa pour le transport et la communication des cultures bactériennes et de l’information. Ainsi Park fit-il confectionner des « trousses de culture bactériologique » (de petites boîtes en bois contenant une éprouvette stérile, un bâton de prélèvement, des instructions et un formulaire vierge) qu’il laissa, partout en ville, à quarante endroits différents (des « stations »), où des praticiens privés pouvaient les prendre gratuitement et les redéposer une fois que des prélèvements de crachat avaient été faits. Les stations étaient les boutiques de pharmaciens privés, qui donnaient par là même aux médecins voisins une raison supplémentaire de fréquenter leurs officines. C’était ensuite au collecteur du département (Department Collector), dont c’était la fonction spécifique, de récupérer les boîtes en fin de journée. Pour connaître les résultats d’un prélèvement, les médecins téléphonaient au « 1191 Spring », le lendemain vers midi, ou bien ils attendaient de recevoir un rapport par le courrier de l’après-midi20. On voit donc comment les éprouvettes et les populations furent mises en contact pour la première fois d’une ville à l’autre selon leurs agencements physiques et sociaux urbains respectifs, très différents : Manhattan, la grille de transports et de communication efficaces, comprenant la poste et le téléphone ; Paris, la ville du loisir et des spectacles en plein air, la ville des promenades le long des rues.

« Il n’y a pas eu depuis longtemps de bons cas à l’hôpital, c’est-à-dire de diphtéries bénignes chez un enfant du quartier que l’on puisse suivre après la guérison », se plaignait Yersin en novembre 1889 21. Il prit donc également sa bicyclette. Les Parisiens venaient de découvrir les banlieues qui se développaient le long de la Seine à l’ouest de la ville ; avec l’expansion des lignes de chemin de fer à partir de la gare Saint-Lazare, elles s’étaient transformées en ces avant-postes d’excursion à la « campagne » que les impressionnistes capturaient sur la toile. Yersin avait commencé par les explorer à bicyclette ; par la suite, jour après jour, durant des semaines, il devait y retourner à bicyclette (et parfois par le train), muni de ses éprouvettes, pour étudier l’ensemble d’une famille (à Nanterre en particulier)22.
espaces savantscirculationmobilitéLa bactériologie urbaine de Yersin avait effectivement pour sujet l’actualité quotidienne des microbes et leur virulence, la fugitive microscopie des gorges de la ville, jour après jour. Il mettait sous le terme d’étiologie non pas l’étude des causes des pathologies, mais celle de « la façon dont les microbes se comportent », avant et après la maladie23 – la vie quotidienne des microbes. Les suivre exigeait la « vélocité » que Baudelaire reconnaissait au peintre de la vie moderne24 : le savant filait par les rues à vélo avec ses éprouvettes et procédait à des « petites manœuvres » de « deux secondes » d’une langue à l’autre. Les mécanismes de l’immunité, la chimie des toxines et des antitoxines, la biologie de la virulence et de la variation, les débats en vigueur sur l’étiologie et l’épidémiologie, ce n’était pas son affaire. Et ni les cobayes en laboratoire ni les patients à la clinique ni l’élaboration d’une théorie n’auraient permis à Yersin de saisir la « vérité de plein air », passagère et pourtant si réelle, des infections changeantes de la ville.
1.2. Les Mystères, les Mohicans et les Misérables de Paris
espaces savantslieulaboratoireLe laboratoire, la clinique, la ville : l’activité de Yersin les a confondus dans un espace de connaissance continu. Si le laboratoire et la clinique étaient par définition des lieux de production du savoir, la ville sociale avait été pour ainsi dire l’antithèse même d’un site et d’un objet de connaissance bactériologique ou épidémiologique. On savait isoler les bactéries dans les conduites d’adduction des eaux ou chez des individus malades, mais non pas dans la population dans son ensemble. Pour la plus grande partie du xix e siècle, les investigateurs épidémiologistes ont évité Paris. Sa complexité sociale excluait que l’on puisse dépister des cas et des modes de transmission. L’enquête épidémiologique se concentrait donc sur son apparition dans de petites communautés rurales25. « À Paris, comme dans toutes les grandes villes », notait un contemporain, « les faits de contagion aussi fréquents qu’une maladie [comme la typhoïde] peuvent rarement être observés de façon concluante26. » D’un point de vue épidémiologique, la cohue urbaine était l’inconnaissable par excellence.
Il y avait assurément des secrets bactériologiques et épidémiologiques cachés dans la population de Paris, mais, pour Yersin, ils étaient susceptibles d’investigation et connaissables. Et pour apprendre à les connaître, il mit au point une manière d’observer la ville, de l’explorer et de se la représenter dont il n’empruntait pas le modèle à l’histoire, à la géographie et à la culture de la bourgeoisie, mais qu’il puisait dans les représentations et les lieux des classes inférieures.
pratiques savantespratique lettréelectureComment le vieux Paris pouvait-il servir de modèle à Yersin ? Par les livres. Il lisait autant qu’il marchait et qu’il décrivait, une lettre après une autre, ses parcours dans la ville. La bourgeoisie avait dépeint ce monde (et prêté l’oreille au langage secret de son argot) en suivant les aventures de ces investigateurs solitaires et déguisés qu’étaient les héros des premiers romans de masse, à commencer par leur prototype, Les Mystères de Paris d’Eugène Sue (1843-1844), qui influença à son tour Les Mohicans de Paris d’Alexandre Dumas (1856-1857) et Les Misérables de Victor Hugo (1862), dont l’action se déroulait dans la première moitié du xix e siècle. Tandis que, « pour comprendre Paris », Freud s’asseyait dans la cathédrale pour lire Notre-Dame de Paris, le roman de Victor Hugo qui se situait au cœur de l’époque médiévale, Yersin apprit à comprendre Paris en lisant, au moins deux fois, Les Misérables, le roman de Hugo qui se situait dans le labyrinthe de l’espace physique et social de la ville du xix e siècle 27.
inscription des savoirsvisualisationvisualisation de l'informationcarte espaces savantscirculationexplorationLes explorations de Yersin le conduisirent d’emblée dans le vieux Paris. En novembre 1885, par exemple, il parcourut le fameux cimetière du Père-Lachaise, et cela sans guide sinon sans carte, et en évitant soigneusement de mettre ses pas dans ceux des touristes : « En sortant du Père-Lachaise, je me lance plan en main à travers un dédale de ruelles qui ne sont rien moins que propres et où on sent tout particulièrement cette curieuse odeur… Les enfants sont en guenilles et paraissent à moitié sauvages. » Il continua : « Figure-toi un étroit passage entre des maisons. Le sol en est noir et visqueux, un ruisseau boueux coule au milieu, quelques enfants barbotent dedans28. » En 1889, Yersin sut transformer les secrets sociaux de Paris en secrets bactériologiques, et de même que les premiers étaient susceptibles d’être découverts et éclairés, il eut accès aux seconds par sa manière d’examiner « en ville » les corps en bonne santé et par les éprouvettes qu’il transportait partout avec lui.
Je ne veux pas dire ici seulement que Yersin créa une bactériologie typiquement parisienne à partir des formes et fictions de la vie quotidienne propre à cette ville, mais également que son type de recherche et la transformation de la ville en un espace de connaissance bactériologique présupposaient le Paris du plein air, mais aussi le Paris de ces romans et de ces formes de vie ordinaire, le Paris des secrets susceptibles d’être sondés. Ce Paris était difficile à pénétrer dans les années 1880. Cela explique que le roman ait pu servir à Yersin de guide dans ses voyages à travers le temps aussi bien qu’à travers l’espace.
Les romans de Sue, de Dumas et de Hugo préparaient le terrain pour l’essor du plus moderne et du plus urbain des genres littéraires, à savoir le roman policier29. Les Mohicans de James Fenimore Cooper furent une des sources d’inspiration de ce nouveau genre, comme Sue le reconnaît dans sa préface et Dumas dans le titre même. À la fin de 1886, après un an en ville, peut-être frappé par une des « horribles » affiches de Freud, Yersin acheta « cinq volumes de Cooper », y compris Le Dernier des Mohicans et La Prairie, et il attendait avec impatience le moment de pouvoir les dévorer, le dimanche30. D’une part les « Mohicans » de Paris étaient ses « sauvages », ceux qui vivaient en dehors de la loi (des criminels) et de la civilisation (les misérables, spécialement les gamins déguenillés). D’autre part, ils étaient les vrais habitants de la ville et ses véritables connaisseurs, ses indigènes, les seuls à avoir les sens et les talents indispensables pour vivre, traquer, chasser, dans sa vaste jungle.
Suivre, tels étaient le mot clé et la pratique qui combinaient flânerie, médecine, police, crime et Les Misérables, entre autres romans qui anticipaient le roman policier. Le terme renvoyait au personnage de l’observateur invisible et voyant tout, le « Protée », une image commune au criminel, à la police, au flâneur et au romancier. Comme les Goncourt l’écrivent dans leur journal en 1864 : « Un auteur doit être dans son livre comme la police dans une ville : partout et nulle part31. » En 1889, quand Yersin quittait l’hôpital des Enfants malades (« Je suis en ville des enfants guéris et sortis de l’hôpital »), des lecteurs de Paris-Secret entraient dans l’hôpital derrière Ignotius, l’auteur-flâneur, soi-disant « portraitiste » littéraire qui suivait, lui aussi, les enfants de la ville. Ignotius arrive au chapitre xxv devant le grand portail des Enfants malades. Mais comment entrer ? Ce n’est pas un problème pour le flâneur expert : « J’ai suivi une mère » et son enfant à l’intérieur de l’hôpital ; il assiste aux procédures élaborées du vaste hall d’admissions, où il faut prendre un numéro comme à la Banque de France, puis les accompagne à travers l’hôpital, étrangement animé, où règne non pas le silence mais le bourdonnement des bavardages de ces « enfants sauvages32 ». En suivant « en ville des enfants », Yersin fondait en une deux acceptions du verbe suivre propres au xix e siècle : la signification médicale (suivre l’évolution de la maladie d’un patient) et la signification policière, qui s’appliquait à tous ces marginaux, notamment les caractères développés par le livre qui servait de guide à Yersin dans la métropole, Les Misérables 33.
La comparaison avec l’épidémiologie dite en chaussures de randonnée (shoe leather), apparue légèrement après, permet de prendre encore mieux la mesure de la spécificité de la pratique de Yersin par rapport à la culture et à la littérature urbaines de son temps. Dans cette forme plus récente d’enquête épidémiologique, semblable en cela à une vraie histoire de détective, le poursuivant ne sait pas qui il traque et, qui plus est, il doit trouver les indices, les traces, pour résoudre l’énigme d’un cas ou d’une irruption de maladie isolés34. Au contraire, une telle énigme n’existe pas dans la bactériologie de terrain de Yersin, ni dans les romans de Sue, Dumas et Hugo (ni dans la littérature de flânerie dont Paris-Secret est le meilleur exemple). Ici le mystère ne réside pas dans le sombre labyrinthe du vieux Paris ni dans la foule indéchiffrable, atomisée de la nouvelle métropole. Quand les criminels « suivent » leurs victimes, ou les inspecteurs de police les criminels (et vice-versa), le poursuivant connaît toujours l’identité de la personne qu’il poursuit. Il y a un parallèle entre l’activité policière, la forme narrative de ces romans et la pratique de Yersin, exactement comme il y a un parallèle entre la pratique de l’épidémiologie en chaussures de randonnée, le travail du détective et la structure narrative tout à fait différente des romans policiers.
Pour autant cela ne signifie pas qu’il n’y aurait pas de suspense, que tout serait su. Javert trouvera-t-il Valjean, et où ? Où Yersin trouvera-t-il les bacilles et que sera leur virulence ? Chaque semaine, comme Yersin l’écrivit à sa mère le 30 juin 1889, « J’ai été en courses pour aller recueillir le microbe de la diphtérie chez divers enfants ayant eu cette maladie depuis un temps plus ou moins long. Il s’agit de savoir combien de temps il peut conserver sa virulence35. » De retour au laboratoire, l’inoculation aux cochons d’Inde des cultures prélevées par intervalles dans les gorges de patients guéris avait tendance à causer peu à peu de moins en moins de décès chez les cochons d’Inde36. La guérison, semblait-il, impliquait une atténuation de la virulence. Pourtant des ambiguïtés et des surprises restaient. « Figure-toi que nous venons de trouver que le bacille diphtérique peut persister dans la bouche des enfants avec toute sa virulence alors que les fausses membranes ont entièrement disparu. C’est un fait très curieux et très important aussi37. »
L’étude familiale la plus étendue de Yersin fut celle qui l’obligea à faire de constants aller-retour à Nanterre, à vélo et par le train, entre novembre et décembre 1889. Des cinq enfants Chennebault, tous sauf l’aînée, la petite Marie, âgée de onze ans, avaient été admis à peu près à la même date aux Enfants malades et renvoyés chez eux après guérison. Marie était la source d’un résultat étrange : une infection virulente qui avait persisté des semaines après guérison. Une culture de la gorge saine de Marie présenta de nombreuses colonies spécifiques, dont quatre ne transmirent pas la maladie aux cochons d’Inde, mais des bacilles venant d’une des colonies tuèrent un cochon d’Inde. Et Marie n’avait pas été malade du tout38.
inscription des savoirsvisualisationimagetableauGénéralement, cependant, les résultats des examens bactériologiques de Yersin sur les enfants Chennebault donnaient des arguments en faveur de l’hypothèse que la guérison s’accompagnait d’une atténuation de la virulence. Par exemple, Marcel, sept ans, était rentré à la maison depuis six jours quand Yersin isola de sa gorge trois colonies de ce qui s’avéra être le bacille de la diphtérie ; l’une d’entre elles tua un cochon d’Inde. Une des trois colonies d’un prélèvement réalisé deux jours plus tard tua encore un cochon d’Inde. Cinq jours plus tard, cependant, trois colonies ne firent aucun effet à trois cochons d’Inde39. La corrélation entre guérison et augmentation du nombre de bacilles pseudodiphtériques non virulents semblait établie. Toutefois, à peu près à la même époque, en novembre 1889, Roux et Yersin avaient fini par réussir à effectuer en laboratoire l’atténuation des bacilles de la diphtérie virulents. Ainsi donc émergeait entre le laboratoire, la clinique et la ville un tableau plutôt cohérent de la manière dont les microbes se « comportaient », comme Yersin l’avait formulé, « après » la maladie. Mais quel était leur comportement « avant » la maladie ? Roux et Yersin avaient besoin de montrer qu’il était possible, dans des conditions de laboratoire, de rendre leur virulence à des bacilles de diphtérie atténués. Et ils avaient besoin d’évaluer plus précisément la diffusion du bacille atténué ou pseudodiphtérique. En fait, il restait des doutes sur la relation véritable entre les deux types de bacilles, pseudodiphtérique et diphtérique.
construction des savoirsvalidationexpérimentationCe fut à ce moment qu’ils imaginèrent une curieuse expérience de terrain, à vrai dire sans précédent, et qui illustre largement les différences de méthode entre Roux et Yersin. Yersin put la mener à bien là encore grâce à une forme de loisir extérieur née au xix e siècle du phénomène de l’urbanisation et de la métropole : les excursions hors de la ville.
1.3. La ville et la campagne
Le vendredi 20 décembre 1889, Alexandre Yersin prit le train à la gare Saint-Lazare. Sa destination : le village de pêcheurs de Grandcamp sur la côte normande, où il avait passé des vacances quelques mois auparavant. Environ dix ans plus tôt, Paris avait découvert la mer ; et des villages comme Grandcamp, avec l’aide des lignes de chemin de fer récemment construites, devinrent les stations de villégiature de la ville et les avant-postes des peintres40. Dans une lettre du 14 décembre aux autorités scolaires locales, Roux avait demandé à examiner les élèves, en expliquant : « Dans le cours de nos recherches, nous avons été amenés à comparer les microbes de la bouche chez les enfants sains et chez les enfants malades. » Il avait été possible d’examiner à Paris, sur le plan bactériologique, un assez bon nombre d’enfants en bonne santé. « Mais la grande ville est un lieu où les contaminations sont faciles, et il est probable que les résultats seraient différents si nous portions nos investigations sur des enfants habitant la campagne loin de toute contagion… [et] dans des conditions spéciales de salubrité41. »
Les autorités avaient fait droit à la demande de Roux, et à dix heures, le matin du 21 décembre, le premier écolier se tenait debout devant Yersin, la bouche grande ouverte. En quelques mouvements rapides, le jeune médecin préleva un morceau de mucus dans une éprouvette. Cette opération de deux secondes fut répétée sur trente et un de ses camarades et, après le déjeuner, sur dix-sept autres enfants du village. « Tous sont en bonne santé », écrivit Yersin dans son carnet de laboratoire, « et depuis quatre ans au moins, il n’y aurait pas eu de diphtérie à Grandcamp 42. » De retour au laboratoire, Yersin examina les cultures et trouva des colonies de bacilles de diphtérie dans la moitié d’entre elles. Il analysa huit de ses cultures sur des cochons d’Inde. Ce jour-là et le lendemain, il surveilla les animaux d’aussi près que d’habitude. Il ne se passa rien : tous les huit étaient « bien », de même que deux lapins inoculés avec du filtrat43. Quoique en bonne santé, les enfants de la campagne n’étaient de toute évidence « pas si loin de toute contagion », contrairement à ce que Roux avait affirmé, même si cette contagion était atténuée.
« Notre expérience de Grandcamp nous a donné un résultat auquel nous ne nous attendions pas du tout », écrivait Yersin à sa mère. À peu près la moitié des bouches abritait des bacilles de diphtérie atténuée, « et cependant les cas de diphtérie sont rares dans le pays. Il faut donc que ce bacille se trouve fréquemment à l’état non virulent dans la bouche et qu’il ne reprenne que très difficilement sa virulence44 ». Pourquoi ce résultait les aurait-il surpris ? Ne leur fournissait-il pas un argument bienvenu en faveur de l’étiologie du retour à la virulence dont Pasteur et Roux avaient fait l’hypothèse en 1881 ? Évidemment pas. Roux pensait que l’étiologie du retour à la virulence ne se manifesterait que dans les zones endémiques, c’est-à-dire dans les villes, et que la fréquence de l’infection avec les bacilles virulents comme avec les bacilles non virulents devait décliner abruptement avec la distance (« loin de toute contagion ») et le changement des conditions (la « salubrité » de Grandcamp)45. Il pensait aussi que là où la diphtérie clinique était absente depuis si longtemps (cinq ans à Grandcamp), même les bacilles atténués devaient avoir disparu. Les résultats de l’expérience de Grandcamp firent resurgir un doute fondamental : le bacille pseudodiphtérique de Loeffler n’était-il pas après tout une espèce distincte ?
espaces savantslieulaboratoireCes problèmes pouvaient être en partie abordés en laboratoire : il suffisait d’essayer de faire revenir à la virulence les cultures de bacilles non virulents. En quelques mois, au début de 1890, Roux et Yersin comprirent qu’ils avaient réussi. Cependant, c’était une démonstration de laboratoire, et non pas sur le terrain. La signification de la différence entre la ville et la campagne restait peu claire. Le travail d’interprétation allait se prolonger jusqu’à une date avancée, au milieu de l’été, et Roux finirait par interpréter les résultats surprenants de l’expérience à la lumière d’une excursion qu’il fit à la campagne et qui était d’une tout autre nature.
À la mi-mai 1890, alors que Yersin et lui étaient en train de boucler leur recherche sur la diphtérie, Roux commença à cracher du sang. Roux, le principal collaborateur de Pasteur dans les découvertes liées au vaccin, était lui-même infecté des micro-organismes de la tuberculose. Depuis sa première attaque en 1883, il avait traversé des épisodes de congestion pulmonaire, avec fièvre et toux de sang. Il serait faux de dire, pourtant, que Roux « avait la tuberculose ». Tout en étant lui-même un médecin et un fondateur de la bactériologie médicale, il ne se représentait pas son état de santé comme une maladie définie en tant que telle. Au contraire, il en parlait comme d’une maladie qui provenait de sa vie dans le laboratoire et en ville, et retenait surtout dans cette expérience le fait qu’elle menaçait d’interrompre son travail.
Roux ne quitta pas la ville et son laboratoire au cours de l’été 1890 sans prendre avec lui ses notes de recherche. « C’est que depuis trois semaines je me suis mis à écrire un article sur la diphtérie, d’abord cela n’allait pas du tout, je travaillais avec peine, et je croyais que véritablement j’étais devenu très bête », confia-t-il à Metchnikoff en juillet. Les résultats de la recherche sur la diphtérie ne se combinaient toujours pas. « Je crains fort que le mémoire ne vaille pas grand-chose. Il y avait une quantité de petits faits pas toujours très intéressants46. »

Gravure parue dans Le Petit Journal du 24 septembre 1894.
Une semaine plus tard, cependant, tout s’arrangeait pour Roux : sa santé s’améliora, il avait terminé son manuscrit qu’il posta à Émile Duclaux, l’éditeur des Annales de l’Institut Pasteur. La conclusion la plus remarquable et en même temps la plus sujette à caution de l’article était que le bacille pseudodiphtérique, tel qu’il avait été prélevé dans de nombreuses bouches, pouvait faire retour à la virulence et donner naissance à la maladie. Ces bacilles atténués étaient encore plus susceptibles de revenir à la virulence quand la gorge était enflammée par d’autres infections47.
construction des savoirslanguestyle construction des savoirsépistémologiesignetraceDans l’espace de quelques jours en juillet 1890, Roux était passé du scepticisme et du désespoir nés de cette « quantité de petits faits » à cette conclusion unifiante, d’une audace exceptionnelle sous sa plume, qui devait sceller le style de l’explication étiologique en France pour de nombreuses années à venir, notamment parce que Roux enseignait à l’Institut Pasteur48. Qu’est-ce qui exactement avait conduit Roux à douter de ses recherches et comment réussit-il à surmonter ce doute ? Nous ne saurions le définir avec certitude, faute de détenir quelque témoignage que ce soit, en dehors de l’article publié, de ce que Roux a pensé de la diphtérie pendant cette troisième semaine de juillet. Il semble pourtant raisonnable d’imputer l’essentiel de son trouble aux résultats expérimentaux qui l’ont le plus dérangé, de même que Yersin, pendant leurs recherches : ceux de Grandcamp. Et si nous n’avons pas de témoignage de ce que Roux a pensé de la diphtérie pendant cette période de troubles interprétatifs, ses lettres à Metchnikoff témoignent remarquablement bien des sentiments que son travail lui inspirait et de ce qui le préoccupait – c’est-à-dire sa propre crise de tuberculose et son retour à la santé, à la campagne, dans sa Charente natale.
espaces savantslieulaboratoireC’est la vie de laboratoire, en ville, dans le climat du Nord, qui avait causé la crise de tuberculose de Roux. Il retrouva la santé au soleil, parmi les champs de la France rurale. Ici, comme il l’aurait interprété lui-même, l’atténuation a fait suite au retour à la virulence de sa tuberculose vieille de sept ans. Exactement au moment où Roux ne savait que faire de la « quantité de petits faits » sur la virulence dans le cas de la diphtérie, sa propre santé lui fournissait un modèle unificateur, stable. Elle braqua son attention sur les conditions de récurrence et sur le remède ordinaire à suivre en cas de phtisie – un séjour à la campagne, de préférence au soleil, sous le climat sec du Sud, du repos et/ou de l’exercice physique, et surtout la vie en plein air, loin de la ville49.
Ces significations vont au-delà du remède médical, comme nous avons déjà commencé à le voir à travers les exclamations de Roux. Cet été-là, comme il devait faire par la suite tous les ans, Roux a vécu différentes sortes de retour, à la fois dans l’espace et dans le temps : en quittant la ville et ses pathologies, il n’est pas seulement revenu au bain de jouvence rural dans le terroir de sa jeunesse ; il a également renoué avec les modes de vie de primitifs de la France rurale, voire de l’humanité : « Je suis comme les peuples heureux, je n’ai pas d’histoire », dit-il spirituellement aux Metchnikoff50. Par rapport à cet observateur sans racines, moderne et infatigable qu’est Yersin, Roux incarnait le romantique prémoderne, agrarien, anti-urbain, le sauvage enraciné de Rousseau. Partant, l’évolution de Roux était au diapason du culte de la terre et de la revalorisation morale, esthétique, hygiénique et économique de la campagne qui marqua la vie publique française d’après 1890.
Roux mit physiquement en pratique une étiologie de la maladie qui montait de l’intérieur de lui-même dans la ville et qui se tassait à nouveau à la campagne. L’analogie avec sa recherche sur la diphtérie était presque parfaite. Les conditions de son attaque de mai correspondaient précisément à la méthode de laboratoire qu’il avait élaborée avec Yersin pour étudier le retour à la virulence des bacilles de la diphtérie atténués : une association avec d’autres infections. Car la tuberculose latente de Roux cessa d’être bénigne vers le 21 mai 1890 ; et le mois précédent, entre le 11 avril et le 16 mai, lui et Yersin étaient sortis presque chaque jour pour faire des observations et des prélèvements sur des gorges sur un total de quatre-vingts cas à l’hôpital51, cette « terre promise » des microbes52. Ainsi la relation entre la tuberculose de Roux et ses observations sur la diphtérie était-elle plus qu’une analogie entre des apparences : elle semblait relever d’un mécanisme commun.
acteurs de savoiracteur non humainmicro-organisme espaces savantslieulaboratoire construction des savoirsépistémologieméthodeSans doute cette interprétation était-elle bâtie sur la méthode de laboratoire que Roux et Yersin venaient d’inventer pour étudier le retour à la virulence, à savoir associer des infections. Mais le modèle en était, en dernier ressort, la ville, ou plutôt l’idée qu’ils s’en faisaient comme d’un endroit où des micro-organismes atténués, déjà en circulation ou bien arrivant de la campagne, devenaient nocifs, pathogènes, en raison même de la caractéristique de la ville que les pastoriens déclaraient définitive : le fait qu’elle était pleine de contaminations et de contagions. Ainsi la méthode consistant à provoquer le retour à la virulence des cultures atténuées en les associant de propos délibéré avec d’autres infections ne revenait pas à faire une analogie avec la ville, mais plutôt à transformer le laboratoire en ville, ou du moins en une des facettes de la ville, celle qui avait envoyé Yersin à la campagne avec ses éprouvettes.
Ni Roux ni Yersin ne disent clairement que leur méthode vise à transformer le laboratoire en une ville de contagions contrôlées. Mais les circonstances apportent une preuve qui suggère hautement un tel modèle. Vers cette époque, même Roux, le prudent sceptique, était en train de développer une réflexion de type analogique sur l’atténuation, suggérant que sa méthode de laboratoire pour atténuer la diphtérie lui était venue de la clinique par métaphore. « N’existe-t-il pas une certaine analogie entre nos cultures aérées à 39,5° et celles qui se font dans la gorge des malades ? », écrivait-il en juillet 1890. Et dans l’intervalle, la méthode du retour à la virulence en associant des infections engendrait des analogies similaires. « Je pense que c’est ma troisième influenza [cet hiver] qui a préparé le terrain de culture pour le deuxième furoncle », écrivait Yersin à sa mère le 9 février, quelques jours après qu’ils furent, Roux et lui, finalement capables de provoquer de la diphtérie chez un cochon d’Inde en inoculant des coccidies d’érysipèle puis des bacilles atténués. « Et je ne suis pas seul de mon espèce. Depuis mercredi M. Chantemesse a aussi sa troisième influenza ; j’espère qu’il n’aura pas de furoncles consécutifs53. » Les furoncles, comme tout bon pastorien le savait, étaient associés aux staphylocoques, un micro-organisme qui avait été isolé pour la première fois par Pasteur d’un furoncle prélevé sur le cou de Duclaux 54. En mars, Yersin était content de rapporter non pas de nouveaux furoncles, mais « un petit noyau dur qui me donne de l’inquiétude. Il doit certainement renfermer quelques microbes en léthargie55 ». Ce qui l’inquiétait sans aucun doute, c’était de savoir l’effet qu’un nouvel assaut de grippe pourrait avoir sur leur virulence.
construction des savoirsvalidationexpérimentationVus depuis les champs, les résultats de l’expérience de Grandcamp ne ressemblaient plus à une pierre d’achoppement. Les enfants de Paris et ceux de Grandcamp étaient infectés autant les uns que les autres par les bacilles pseudodiphtériques. Pourtant les enfants de Paris souffraient de la diphtérie, alors que ceux de Grandcamp n’en souffraient pas. Mais que faire de cette donnée ? La différence entre la morbidité et la bonne santé était une différence entre la ville et la campagne, même si ce n’était pas exactement celle que Roux avait affirmé qu’il devait trouver. Roux à Paris et Roux en Charente étaient également infectés des bacilles de tuberculose. Pourtant Roux à Paris s’écroula, ses lèvres rougies du sang qu’il crachait de son larynx, tandis que le Roux en Charente grimpait sur les arbres, les lèvres rouges du jus de cerise.
espaces savantsterritoirecampagne espaces savantsterritoirevilleL’histoire que j’ai racontée ici montre comment la ville et la campagne peuvent organiser une expérience concrète individuelle, un mode de vie privée et scientifique, et engendrer un discours, sans être pour autant une métaphore ou une autre forme de représentation. Dans le cas de Roux, nous voyons que la ville et la campagne sont mises en pratique et représentées comme la manière de vivre d’un savant (quitter la ville) et la santé de son corps. Roux est venu à la campagne pour construire une « vie des champs » et contrebalancer la « vie du laboratoire » pathogène, de manière à rétablir son corps et le rendre à la santé. Le processus ou « régime », comme Roux l’a appelé, par lequel le savant guérit son corps et apprend à le maintenir en bonne santé ne fait pas de son corps un meilleur instrument scientifique, mais plutôt un modèle56. Se sauver soi-même de la tuberculose en quittant la ville ; se camper dans la posture de l’agrarien prémoderne en pleine période de revalorisation de la terre et des champs propre à la IIIe République ; résoudre la perplexité dans l’interprétation des données bactériologiques ; constituer une étiologie et une épidémiologie générales pastoriennes : il y avait tout cela à la fois dans le comportement de Roux.
Et qu’en est-il de celui de Yersin ? Le jeune médecin aurait pu faire souche à Paris, mettre en place un cabinet privé ou poursuivre sa carrière dans les hôpitaux parisiens ou même à l’Institut Pasteur57. Mais il ne le fit pas.
Après avoir découvert la mer à Grandcamp (et, avec le même plaisir, des gens exotiques à la foire mondiale de Paris de 1889, dans des spectacles vivants au pied de ce nouveau prodige moderne qu’était la Tour Eiffel58), Yersin ne partit pas pour rentrer chez lui, mais pour l’Indochine, où il continua sa vie d’explorateur infatigable. Assez vite, en poussant sa première exploration du « territoire inconnu » des montagnes dans des conditions si rigoureuses que ses chaussures furent bientôt usées et qu’il dut continuer « pieds nus » pendant dix jours, Yersin a pleinement accédé au statut du gamin errant de Hugo, ce héros de Paris, sans chaussures, à moitié sauvage, et il s’est pleinement identifié à ce voyageur en haillons qu’est Jean Valjean. « Il est si enchanté de cette exploration », écrivait Roux à Madame Metchnikoff en 1891 « qu’il demande à être officiellement chargé d’un voyage de découvertes dans le même pays. C’est un garçon bien original, toujours à la recherche de quelque sensation nouvelle59. »
(Traduit de l’anglais par Sylvie Taussig.)
Ce texte a fait l’objet d’une première publication en anglais dans la revue Osiris (2003, 18, p. 150-170). Nous remercions l’éditeur d’avoir autorisé la publication de cette version française légèrement remaniée.
* Pour l’accès à des documents non publiés dont je reproduis des extraits, je tiens à remercier l’équipe des Archives de l’Institut Pasteur, et en particulier son ancienne directrice, Denise Ogilvie, et Daniel Demellier ; l’équipe des Archives de l’AP-HP, et en particulier Sophie Riché ; Henri H. Mollaret et la regrettée Jacqueline Brossollet, ainsi que Bernardino Fantini et son équipe de l’université de Genève.
Correspondance de Yersin, les 31 octobre, 11 et 13 novembre 1885.
Correspondance de Yersin, les 7 et 13 novembre 1885.
Perrot, 1972 ; Lecuyer, 1977, vol. 1, p. 445-476 ; Coleman, 1982 et 1987 ; Aisenberg, 1999.
Mendelsohn, 2002.
Roux et Yersin, 1890, p. 385-426 ; AIP (Archives de l’Institut Pasteur) : Fonds Yersin, 12 cahiers de recherche (1887-1891), rangé sous la cote Tonsite (cité par la suite comme Yersin, Tonsite) : Tonsite V, p. 8 ; Tonsite VI, p. 3, passim ; Tonsite VII, p. 1-14.
AP-HP, Hôpital des Enfants malades, registre des entrées, 1889, no 1932. AIP : Yersin, « Diphtéries suivies après la guérison », 1889, p. 3.
Bouchut, 1884, p. 586.
Cité par Cachin, 1997, vol. 1, p. 957-996 et, notamment, p. 987.
Du Maroussem, 1900, p. 5. Voir Duclaux, 1902. Ils furent publiés tous deux dans la collection « Bibliothèque générale des sciences sociales », éditée par Dick May, École des hautes études sociales, dont Duclaux devint le directeur. Du Maroussem dirigea une enquête socio-économique à long terme dans la tradition du livre classique de l’ingénieur Frédéric Le Play, Les Ouvriers européens (1855).
Benjamin, 1974, p. 52.
Huart, 1841.
Herbert et al., 1988, p. 23.
Voir Tester, 1994.
Freud à Minna Bernays, 3 décembre 1885, in Freud, 1960, p. 200.
Correspondance de Yersin, le 31 octobre 1885 ; voir Schwartz, 1998, chap. II.
Goldstein, 1984, p. 181-222, particulièrement. p. 181.
Baudelaire, 1999, p. 511-514.
Voir Hammonds, 1999.
Picon, 1994, p. 137-151.
Biggs, 1895, p. 3-6.
Correspondance de Yersin, le 10 novembre 1889.
AP-HP : Hôpital des Enfants malades, registre des entrées, 1889, no 4181. AIP : Yersin, Tonsite VIII, p. 7-8, 22, 32, 34. Correspondance de Yersin, le 8 décembre 1889 ; 1-15 septembre 1889 (sur la bicyclette).
Correspondance de Yersin, le 16 juin 1889.
Baudelaire, 1999, p. 507 ; Herbert et al., 1988, chap. i.
Coleman, 1987, p. 20-21.
Ackerknecht, 1948, p. 589.
Freud à Minna Bernays, le 3 décembre 1885, FREUD, 1960, p. 200 ; Correspondance de Yersin, le 3 mars 1889.
Correspondance de Yersin, le 21 novembre 1889.
Messac, 1975, chap. ii-iii.
Correspondance de Yersin : 26 septembre 1886.
Burton, 1988, p. 61 ; cité in Goncourt, 1956, 27 mai 1864, II, p. 48.
Ignotius [Félix Patel], 1889, chap. XXV.
Voir le Trésor de la langue français : dictionnaire de la langue du xix e et du xx e siècle (1789-1960), éd. P. Imbs, Paris, 1971-1994), 16 vol., s.v. « suivre ».
Le cas classique est Soper, 1919, p. 1-15.
Correspondance de Yersin, le 30 juin 1889.
AIP : Yersin, « Diphtéries examinées après guérison » et « Diphtéries suivies après guérison », 8 ff., 1889.
Correspondance de Yersin, le 25 juin 1889.
Yersin, Tonsite VIII, p. 34, 41-42, 45 ; Tonsite IX, p. 8-9.
Yersin, Tonsite VIII, passim ; Tonsite IX, p. 8-9.
Herbert, 1998.
AIP : Roux au recteur de l’Académie de Caen, 14 décembre 1889 ; copie dans Yersin, Tonsite IX, p. 18-19.
AIP : Yersin, Tonsite IX, p. 19.
AIP : Yersin, Tonsite IX, p. 20, 24.
Correspondance de Yersin, le 29 décembre 1889.
Pour ce type de raisonnement parmi les pasteuriens, voir Duclaux, 1885, p. 199.
AIP : Roux aux Metchnikoff, le 13 juillet 1890.
Roux et Yersin, cités supra.
AIP : Émile Roux, « Virulence et immunité », notes manuscrites d’un étudiant des Cours de M. Roux (1894), vol. 9, 45e et dernière leçon.
Voir Dubos, 1992.
AIP : Roux aux Metchnikoff, le 10 septembre 1893 ; Roux à Madame Duclaux, le 2 octobre 1907.
AIP : Yersin, Tonsite XII, p. 1-38.
Duclaux, 1884, p. 742-752, et précisément p. 742.
Correspondance de Yersin, le 9 février 1890.
Duclaux, 1896.
Correspondance de Yersin, le 23 mars 1890.
AIP : Roux aux Metchnikoff, les 4 septembre 1890 et 22 septembre 1893. Sur le corps comme instrument, voir Sibum, 1998, p. 23-57 ; Smith, 2004.
Voir, par exemple, Rosenberg, 1992.
Correspondance de Yersin (1889).
AIP : Roux à Madame Metchnikoff, le 29 septembre 1891.
Appendix A Bibliographie
- Ackerknecht, 1948 : Ackerknecht, « Anticontagionism between 1821 and 1867 »,Bulletin d’histoire Méd. 22, p. 562-593.
- Agulhon, 1977 : Maurice Agulhon, Le Cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848, Paris.
- Aisenberg, 1999 : Andrew Aisenberg, Contagion : Disease, Government, and the « Social Question » in Nineteenth-Century France, Stanford.
- Alphand, 1867-1873 : Adolphe Alphand, Les Promenades de Paris, 2 vol., Paris.
- Baldwin, 1999 : Peter Baldwin, Contagion and the State in Europe, 1830-1930, Cambridge.
- Blackbourn, 1993 : David Blackbourn, The Marpingen Visions : Rationalism, Religion and the Rise of Modern Germany, Oxford.
- Baudelaire, 1998 : Charles Baudelaire, « Les foules », in Spleen de Paris : petits poèmes en prose, Paris, p. 44-46.
- Baudelaire, 1999 : Ch. Baudelaire, « Le peintre de la vie moderne » (1863), Écrits sur l’art, Paris, p. 503-552.
- Barral, 1968 : Pierre Barral, Les Agrariens français de Méline à Pisani, Paris, p. 128-140.
- Bédarida et Sutcliffe, 1980 : François Bédarida et Anthony Sutcliffe, « The Street in the Structure and Life of the City : Reflections on Nineteenth-Century London and Paris », Journal of Urban History, 6, p. 379-396.
- Benjamin, 1974 : Walter Benjamin, Charles Baudelaire : Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus, éd. R. Tiedemann, Francfort-sur-le-Main.
- Berman, 1982 : Marshall Berman, All That is Solid Melts into Air : The Experience of Modernity, New York.
- Biggs, 1895 : Hermann M. Biggs et al., Report on Bacteriological Investigations and Diagnosis of Diphteria, From May 4, 1893 to May 4, 1894, in Health Department, City of New York, Scientific Bulletin, no 1, New York.
- Bouchut, 1884 : Eugène Bouchut, Clinique de l’hôpital des Enfants malades, Paris.
- Brand, 1991 : Dana Brand, The Spectator and the City in Nineteenth-Century American Literature, Cambridge.
- Burrows et Wallace, 1999 : Edwin G. Burrows et Mike Wallace, Gotham : A History of New York City to 1898, Oxford.
- Burton, 1988 : Richard D. E. Burton, « The Unseen Seer, or Proteus in the City : Aspects of a Nineteenth-Century Parisisian Myth », French Studies, 42, p. 50-68.
- Burton, 1994 : R. D. E. Burton, The Flaneur and His City : Patterns of Daily Life in Paris, 1815-1850, Durham.
- Cachin, 1997 : Françoise Cachin, « Le paysage du peintre », in P. Nora (éd.), Les Lieux de mémoire, 2 vol., Paris, vol. 1, p. 957-996.
- Chevalier, 1958 : Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du xix e siècle, Paris.
- Clark, 1984 : T. J. Clark, The Painting of Modern Life : Paris in the Art of Manet and His Followers, Londres.
- Coleman, 1974 : William Coleman, « Health and Hygiene in the Encyclopédie : A Medical Doctrine for the Bourgeoisie », Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 29, p. 399-421.
- Coleman, 1982 : W. Coleman, Death is a Social Disease : Public Health and Political Economy in Early Industrial France, Madison.
- Coleman, 1987 : W. Coleman, Yellow Fever in the North : The Methods of Early Epidemiology, Madison.
- Csergo, 1995 : Julia Csergo, « Extension et mutation du loisir citadin : Paris xix e siècle - début xx e siècle », in A. Corbin (éd.), L’Avènement des loisirs, 1850-1960, Paris, p. 121-168.
- Donzelot, 1977 : Jacques Donzelot, La Police des familles, Paris.
- Dubos, 1992 : René et Jean Dubos, The White Plague : Tuberculosis, Man and Society, New Brunswick.
- Duclaux, 1884 : Émile Duclaux, « Étude d’un microbe rencontré chez un malade atteint de l’affection dénommée “Clou de Biskra” », Bulletin de l’Académie de médecine, 2e série, 13, p. 742-752.
- Duclaux, 1885 : É. Duclaux, Le Microbe et la maladie, Paris.
- Duclaux, 1896 : É. Duclaux, Pasteur, histoire d’un esprit, Sceaux.
- Duclaux, 1902 : É. Duclaux, L’Hygiène sociale, Paris.
- Du Maroussem, 1900 : Pierre Du Maroussem, Les Enquêtes : pratique et théorie, Paris.
- Evans, 1987 : Richard J. Evans, Death in Hamburg : Society and Politics in the Cholera Years, 1830-1910, Oxford.
- Foucault, 1975 : Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison, Paris.
- Freud, 1960 : Sigmund Freud, Correspondance (1873-1939), éd. E. L. Freud, trad. par A. Berman et J.-P. Grossein, Paris.
- Goldstein, 1984 : Jan Goldstein, « Moral Contagion », in Professions and the French State, 1700-1900, éd. Gerald L. Geison, Philadelphie.
- Goncourt, 1956 : Edmond et Jules de Goncourt, Journal : mémoires de la vie littéraire, éd. R. Ricatte.
- Green, 1990 : Nicholas Green, The Spectacle of Nature : Landscape and Bourgeois Identity in Nineteenth-Century France, Manchester.
- Hammonds, 1999 : Evelynn Maxine Hammonds, Childhood’s Deadly Scourge : The Campaign to Control Diphteria in New York City, 1880-1930, Baltimore.
- Herbert et al., 1988 : Robert L. Herbert, Impressionism : Art, Leisure, and Parisian Society, New Haven.
- Herbert et al., 1991 : R. L. Herbert et al., Georges Seurat, 1859-1891, New York.
- Herbert, 1998 : R. L. Herbert, Monet on the Normandy Coast : Tourism and Painting, 1867-1886, New Haven.
- Houssel et al., 1976 : J.-P. Houssel et al., Histoire des paysans français du xviii e siècle à nos jours, Roanne, p. 398.
- Huart, 1841 : Louis Huart, Physiologie du flâneur, Paris.
- Ignotius, 1889 : Ignotius [Félix Patel], Paris-Secret, Paris.
- Kalika, 2000 : Dominique Kalika, Naissance de la police privée : détectives et agences de recherches en France, 1832-1942, Paris.
- Kern, 1983 : Stephen Kern, The Culture of Time and Space, 1880-1918, Cambridge (Mass.).
- Koch, 1893 : Robert Koch, « Die Cholera in Deutschland während des Winters 1892 bis 1893 », Zeitschrift für Hygiene und Infekstionskrankheiten, 15, p. 89-165.
- Köhn, 1998 : Eckardt Köhn, Strassenrausch : Flanerie und kleine Form. Versuch zur Literaturgeschichte des Flaneurs von 1830-1933, Berlin et Francfort-sur-le-Main.
- Kolle, 1895 : Wilhelm Kolle, « Die Massnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Tuberkulose und Diphterie in Nord-Amerika », Zeitschrift für Hygiene und Infeks tionskrankheiten, 19, p. 139-152 ; « rationell », passim.
- Lawrence et Shapin, 1998 : Christopher Lawrence et Steven Shapin (éd.), Science Incarnate : Historical Embodiments of Natural Knowledge, Chicago.
- Lecuyer, 1977 : Bernard-Pierre Lecuyer, « Médecins et observateurs sociaux : les Annales d’hygiène publique et de médecine légale (1820-1850) », in Pour une histoire de la statistique, 2 vol., Paris, vol. 1, p. 445-476.
- Ledingham et Arkwright, 1912 : J. C. G. Ledingham et J. A. Arkwright, The Carrier Problem in Infectious Diseases, New York.
- Lees, 1985 : Andrew Lees, Cities Perceived : Urban Society in European and American Thought, New York.
- Lehan, 1998 : Richard Lehan, The City in Literature : An Intellectual and Cultural History, Berkeley, chap. iv-v.
- Lhéritier, 1958 : Andrée Lhéritier (éd.), Les Physiologies : catalogue des collections de la Bibliothèque nationale, Paris.
- Lindner, 1990 : Rolf Lindner, Die Entdeckung der Stadtkultur : Soziologie aus der Erfahrung der Reportage, Francfort-sur-le-Main.
- Martin-Fugier, 1990 : Anne Martin-Fugier, La Vie élégante, ou la Formation du Tout-Paris, 1815-1848, Paris.
- Mendelsohn, 2002 : J. Andrew Mendelsohn, « “Like All That Lives” : Biology, Medicine and Bacteria in the Age of Pasteur and Koch », History and Philosophy of the Life Sciences 24, p. 3-35.
- Messac, 1975 : Régis Messac, Le « Detective Novel » et l’influence de la pensée scientifique [1929], Genève.
- Mollaret et Brossollet, 1985 : Mollaret et Brossollet, Alexandre Yersin : le vainqueur de la peste, Paris.
- Perrot, 1972 : Michelle Perrot, Enquêtes sur la condition ouvrière en France au xix e siècle, Paris.
- Peukert, 1989 : Detlev J. K. Perrot, Max Webers Diagnose der Moderne, Göttingen.
- Picon, 1994 : Antoine Picon, « Les modèles de la métropole : les polytechniciens et l’aménagement de Paris », in Br. Belhoste et al. (éd.), Le Paris des polytechniciens : des ingénieurs dans la ville, 1794-1994, Paris, p. 137-151.
- Rabinow, 1989 : Paul Rabinow, French Modern : Norms and Forms of the Social Environment, Cambridge (Mass.).
- Rearick, 1985 : Charles Rearick , Pleasures of the Belle Époque : Entertainment and Festivity in Turn-of-the-Century France, New Haven.
- Reddy, 1984 : William M. Reddy, The Rise of Market Culture : The Textile Trade and French Society, 1750-1900, Cambridge, p. 174-183.
- Rosenberg, 1992 : Charles E. Rosenberg, « Making It in Urban Medicine : A Career in the Age of Scientific Medicine », Explaining Epidemics and Other Studies in the History of Medicine, Cambridge, chap. 10, p. 230-231.
- Roux et Yersin, 1890 : Émile Roux et Alexandre Yersin, « Contribution à l’étude de la diphtérie (3e mémoire) », Annales de l’Institut Pasteur, 4, p. 385-426.
- Sarasin, 2001 : Philipp Sarasin, Reizbare Maschine : Eine Geschichte des Körpers, 1765-1914, Francfort-sur-le-Main.
- Schorske, 1963 : Carl Schorske, « The Idea of the City in European Thought : Voltaire to Spengler », in O. Handlin et J. Burchard (éd.), The Historian and the City, Cambridge (Mass.), p. 95-114.
- Schwartz, 1998 : Vanessa Schwartz, Spectacular Realities : Early Mass Culture in Fin-de-Siècle Paris, Berkeley.
- Scott, 1998 : James C. Scott, Seing Like a State : How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, New Haven.
- Sennett, 1990 : Richard Sennett, The Conscience of the Eye : The Design and Social Life of Cities, New York, p. 46-62.
- Sibum, 1998 : H. Otto Sibum, « An Old Hand in a New System », in J.-P. Gaudillière et Ilana Löwy (éd.), The Invisible Industrialist : Manufactures and the Production of Scientific Knowledge, Manchester, p. 23-57.
- Smith, 2004 : Pamela Smith, The Body of the Artisan, Chicago.
- Soper, 1919 : George A. Soper, « Typhoid Mary », Military Surgeon 45, p. 1-15
- Sternhell, 1972 : Zeev Sternhell, Maurice Barrès et le nationalisme français, Paris.
- Tester, 1994 : Keith Tester (éd.), The Flâneur, Londres.
- Thiesse, 1984 : Anne-Marie Thiesse, Le Roman du quotidien : lecteurs et lectures populaires à la Belle Époque, Paris.
- Thiesse, 1991 : A.-M. Thiesse, Écrire la France : le mouvement littéraire régionaliste de langue française entre la Belle Époque et la Libération, Paris.
- Trésor de la langue française, 1971-1994 : Trésor de la langue française : dictionnaire de la langue du xix e et du xx e siècle (1789-1960), éd. P. Imbs, Paris, 16 vol., s.v. « suivre ».
- Vialle, 1900 : Émile Vialle, Le Service des douteux à l’hôpital des Enfants malades, thèse méd., Paris.
- Vidal de La Blache, 1911 : Pierre Vidal de La Blache, Tableau de la géographie de la France ; vol. 1 d’Ernest Lavisse, Histoire de la France illustrée, Paris.
- Vidler, 1978 : Anthony Vidler, « The Scenes of the Street », in On Streets, éd. Stanford Anderson, Cambridge (Mass.), p. 29-111.
- Weber, 1948 : Max Weber, « Bureaucracy », in From Max Weber : Essays in Sociology, éd. et trad. H. H. Gerth et C. W. Mills, Londres, p. 196-244.
- Williams, 1993 : Raymond Williams, The Country and the City, Londres.
- Winslow, 1929 : C. E.-A. Winslow, The Life of Hermann M. Biggs : Physician and Statesman of Public Health, Philadelphie.
- Zola, 1983 : Émile Zola, L’Œuvre [1886], Paris.
- Zola, 1986 : É. Zola, Carnets d’enquête : une ethnographie inédite de la France, éd. Henri Mitterand, Paris.