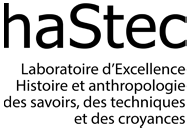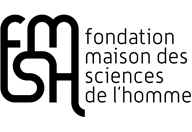1typologie des savoirsdisciplinessciences humaines et socialeshistoirehistoire des sciencesAucun savoir n’est immobile ni immuable. Quand bien même il serait possible d’assigner l’émergence de tel savoir à tel lieu et à tel moment, reste que tout savoir se déplace avec ceux qui le transmettent, s’enrichit ou s’appauvrit selon les aléas des héritages qui le font passer d’un maître à des disciples, d’une génération à la suivante, d’une ville ou d’un pays à d’autres. Nécessairement inscrit dans des paramètres spatio-temporels, chaque savoir est tributaire des techniques changeantes qui le façonnent, le configurent, le véhiculent. Chaque savoir s’étend, se ramifie, se complexifie, s’épanouit ou se dessèche au fur et à mesure que se constituent, se développent, prospèrent ou déclinent les collectifs de ceux qui en sont pour un temps les auteurs et les acteurs : partenaires ou concurrents, iréniques ou agressifs, inventifs ou stériles. Les études de ce chapitre s’intéressent donc aux savoirs dans la mesure où ils sont situés, et entendent les saisir au croisement de deux visées, cartographique et historiographique. Car l’histoire des sciences ne se sépare pas d’une géographie des savoirs.
2construction des savoirstraditionécole de pensée typologie des savoirsdisciplinessciences humaines et socialesphilosophie« Comment définir l’espace-temps des philosophes ? » Posant cette question au terme de son évocation d’une longue histoire (les quelque neuf siècles qui, pour le monde gréco-romain, vont de Pythagore à Plotin), Carlos Lévy l’illustre, plus qu’il n’y répond, par trois constats remarquables : la longévité de l’épicurisme rapportée à la distance que celui-ci sut garder vis-à-vis du politique ; le « mouvement brownien » de philosophes devenus « voyageurs » dans un monde où « l’apparition de nouvelles institutions » avait ébranlé la « centralité » d’Athènes ; l’acculturation sans institutionnalisation que les Romains firent subir à l’école philosophique grecque, la ramenant à cette forme de la simple « relation entre individus par laquelle tout avait commencé ». En effet, mis à part le pythagorisme qui suivit plutôt le chemin inverse, ce n’est qu’après « la génération de Socrate et de Gorgias » qu’on avait, en Grèce, préféré sortir de l’« espace virtuel d’éducation » dans le cadre duquel ceux-ci exerçaient et passer de l’« indétermination géographique » à un « système plus structuré ».
3construction des savoirstradition Micha Perry procède, quant au panorama encore bien plus vaste qu’il déploie de l’histoire juive (du vi e siècle av. J.-C. au xx e apr. J.-C.), par pointage d’un « paradoxe » récurrent : ainsi de l’« oscillation » qui, à l’époque du Second Temple, agitait aussi bien la Palestine que la diaspora, toutes deux écartelées entre une volonté d’auto-affirmation (l’une prétendant « contrôler », l’autre aspirant à l’« autonomie ») et l’impossibilité de sortir d’une « dépendance » réciproque ; ainsi, aux x e-xi e siècles, de l’assurance de « rester le lieu principal du savoir » que la Babylonie tirait du fait même de « l’autonomie croissante des communautés » ; ou encore, dans la Provence des xii e-xiii e siècles, de la rédaction d’une tradition locale qui, visant à « freiner la propagation » d’un savoir externe, contribua au contraire à diffuser celui-ci, renforçant finalement la « globalisation » ; ou enfin, dans l’Europe de l’Est des xvi e-xx e siècles, du « repli » des juifs sur eux-mêmes, aboutissant à préserver l’universalité de leur horizon, lequel avait tendu à se rétrécir en proportion de leur ouverture à la culture du dehors. Série de tensions en accordéon, d’attentes déçues et d’effets inattendus, détournant ou retournant, mais de façon au fond heureuse, les stratégies mises en œuvre. Au bout du compte se verrait confirmée en tout cas la permanence d’un clivage caractéristique : cette « bilocation » qui, à une « double géographie », combine une « double temporalité », faisant que « le savoir juif se trouve toujours à la fois dans un lieu réel et dans un lieu imaginaire ». La notion d’« espace virtuel » que C. Lévy applique à un mode souple et mobile d’éducation pratiqué hors cadre institutionnel dans le monde gréco-romain, mais aussi (j’y reviendrai) à la place d’abord symbolique que Rome ménagea à la philosophie en élevant une statue en son honneur, M. Perry y recourt, quant à lui, pour désigner plus fondamentalement ce sur quoi, dans leur dispersion même, « se rencontraient les juifs du monde entier », c’est-à-dire le savoir comme tel, développé sur la base de la langue hébraïque et de la littérature biblique et rabbinique, savoir « délocalisé » par le livre et dont la transmission multiforme (manuscrite ou imprimée, en original ou en traductions) assura le maintien d’une « structure intellectuelle commune » et d’une « conscience collective » propre.
4On le voit déjà : par-delà leurs différences tant d’objet que de style, les analyses de C. Lévy et de M. Perry relèvent d’une même approche « métahistorique » (M. Perry qualifie d’ailleurs ainsi le « système de pensée » de Simon Doubnov dont il s’inspire). Plutôt que d’articuler des séquences factuelles à la façon d’une histoire événementielle ou de distinguer des contenus doctrinaux dans la perspective d’une histoire des idées, elles font ressortir la cohérence d’une tradition de savoir dans la diversité de ses expressions en spécifiant les modes d’inscription spatio-temporelle de ses pratiques de transmission.
5construction des savoirsépistémologiesignesymboleAinsi encore des écoles philosophiques grecques rapportées à deux institutions, l’Académie et le Lycée, à l’origine simples toponymes sur un plan d’Athènes (évoquant des gymnases). Carlos Lévy souligne comment c’est en perdant leur particularité de noms de lieu, puis leur majuscule de noms propres, que ces appellations ont pris valeur tout d’abord « paradigmatique » (pour les écoles représentatives de la tradition issue de Socrate) et finalement « emblématique » (pour « l’ensemble du système d’éducation en Occident ») : plus-value considérable, même si son caractère surtout symbolique ne permet sans doute pas de l’égaler aux bénéfices paradoxaux attachés à la dialectique somme toute optimiste qu’expose M. Perry, dans le sillage de Doubnov. Carlos Lévy note par ailleurs « l’accent mis sur le temps et non sur l’espace » dans les principaux noms servant à désigner l’activité d’éducation (scholê, temps de loisir ; diatribê, temps passé à converser ; hairesis, choix intellectuel personnel). Conçue comme essentiellement relationnelle, cette activité consista d’abord, en effet, non à « investir un lieu donné », mais à « s’installer dans le temps du jeune auditeur » en vue de sa « transformation intérieure ». Dans le même ordre d’idées, lourde de portée aura été, selon M. Perry, la « révolution » qui signa le « passage progressif du savoir, à l’époque du Second Temple, des mains des Prêtres à celles des Sages » : l’élément « relationnel » l’emporta sur l’« héréditaire », et le « savoir lié au lieu devint un savoir reposant sur l’homme ». D’où notamment la synthèse qu’à Alexandrie Philon dut et put effectuer entre héritage juif et pensée grecque à partir de sa « bilocation intellectuelle » : cas exemplaire d’une performance qui eût été inconcevable sans « cette conscience particulière de l’espace et du temps que résume le mot exil ». À quoi se trouve faire écho la caractérisation par C. Lévy du « statut étrange » qui fut celui de Rome aux yeux des philosophes : « celui d’une ville dans laquelle la philosophie se sentait à la fois chez elle et en exil ». Et ce à l’issue du « processus de transfert » qui s’était opéré vers elle depuis Athènes, à commencer par l’ouverture en son sein d’un « espace virtuel » (érection d’une statue de Pythagore au début du iii e siècle av. J.-C.) qu’elle « actualisa » par la suite, quoique de manière parfois insolite (tels le « fantasme d’école » qu’aura représenté Tusculum chez Cicéron, ou l’« exception » que constitua l’école des Sextii, voulue comme « spécifiquement romaine » mais où l’on philosophait en grec).
6espaces savantslieuatelier pratiques savantespratique lettréecorrespondanceAlors que, chez C. Lévy et M. Perry, il s’agit d’un monde (gréco-romain) et d’un peuple (juif) considérés sur la longue durée, Corinne Bonnet et Véréna Paravel concentrent leurs analyses sur des objets à la fois plus proches de nous (directement contemporain même chez la seconde) et beaucoup plus ciblés, ce qui n’implique pas que l’accommodation du regard à porter sur eux ait été plus aisée. Sensible au fait que « le champ de l’épistolarité savante combine des temps et des espaces multiples et croisés » (ceux « de l’écriture et de la lecture, du récit, des projets et des souvenirs »), C. Bonnet s’est plongée dans la correspondance de Franz Cumont, « production fluide et changeante », corpus « riche » mais « d’exploitation difficile » (pas moins de douze mille pièces en effet pour la seule face passive), où cependant, grâce à ces « paratextes ou métadiscours » que sont les lettres par rapport aux œuvres, s’offre la chance d’accéder à « l’archive de la genèse » de celles-ci. Avec la recherche en réseaux et l’étude de « l’épistolarité électronique », V. Paravel, de son côté, choisit la « voie privilégiée qui conduit au cœur de l’atelier du scientifique », non sans mesurer la complexité de cet espace, « immense chantier », qui « se pose comme un lieu d’articulation entre des formes de sédentarité et des représentations infiniment labiles ».
7Véréna Paravel parle de façon suggestive d’un « espace-mémoire » aux propriétés contrastées : « légèreté des échanges ponctuels qui fluidifient les circulations », mais aussi bien « épaisseur des thésaurisations de tous les accords passés » ; et si elle exalte l’innovation du courrier électronique, « installant la possibilité de passer d’un espace-temps discret à un espace-temps quasi continu », elle se garde d’idéaliser cet « outil envahissant » et souligne aussi à quel point cette « dynamique continue » est exposée à « l’opacité de la médiation des usages individuels », aux aléas « des interactions ratées et des malentendus possibles ».
8espaces savantscirculationréseau Corinne Bonnet a affaire, quant à elle, au « chantier-fourmilière de la République des lettres » (celle-ci vue comme « concept idéal né de l’assemblage des réseaux »), un chantier interdisciplinaire qui évolue au fur et à mesure de cette « circulation des idées » dont l’échange de courrier est le vecteur ; mais, d’une part, soumise à des codes, passée « au filtre de la civilité », « l’épistolarité est aussi un espace de validation des pratiques par le biais d’un langage “sectaire” » ; et, d’autre part, la dynamique de ce réseau vivant et bruissant apparaît vulnérable, sujette à crise et à régression. La guerre fait figure en l’occurrence de « traumatisme » majeur. Elle étend et fait peser la chape d’un « silence subit », elle « déchire le tissu des échanges » et en « rétrécit les territoires ». Au lieu que la science progresse, la voilà devenue « otage ». L’« espace fluide », qui en temps normal se révèle également structuré, se retrouve promptement « figé ». Même Cumont, à qui son « identité scientifique hybride » et sa « pensée nomade » permettaient de traverser avec aisance les frontières linguistiques et culturelles, ne songe plus qu’à « sauver ce qu’on pourra de nos études » (comme il y invite, en 1920, l’Allemand Franz Boll) et se voit contraint de « prendre des distances » que les correspondances étaient faites pour « abolir ». Ainsi, l’usage des instruments de communication aux mains des gens de science se révèle assujetti à des instances – pouvoir politique, propagande idéologique, conditionnements de toutes sortes – susceptibles d’enrayer l’efficacité des techniques et de bloquer les acteurs sur les positions antagonistes qu’on entend leur dicter. Ce dont la censure de l’Internet dans la Chine d’aujourd’hui me paraît reconduire obstinément – et à quel prix – l’obsession.
9De même que la portée des analyses de C. Lévy et de M. Perry est liée au fait que tous deux adoptent un point de vue métahistorique, de même les éclairages fournis par celles de C. Bonnet et de V. Paravel ressortissent-ils à une commune épistémologie de l’intercommunication. Méta-et inter- : ces deux composants – l’un, grec, évoquant un dépassement ; l’autre, latin, marquant la relation réciproque – peuvent devoir à leurs significations premières spatiales et temporelles de n’être pas inadéquats ici où il s’agit précisément d’élaborer quelques-unes des figures qu’a pu prendre en diverses conjonctures l’espace-temps des savoirs.
10Quant à l’intercommunication, les pages consacrées à Cumont soulignent que la guerre « interrompt » les échanges « internationaux », tandis que la montée en puissance des nationalismes exacerbés aboutit à ruiner ce qu’une « Internationale des savants » (avatar de l’ancienne République des lettres) avait vocation à déployer. Corinne Bonnet cite Cumont : « La science, comme la religion, est et doit être internationale. » Plus qu’un fait objectif, c’est là l’affirmation d’un volontarisme éthique. Au fond, la science ne serait-elle pas alors, comme la religion justement, affaire d’engagement sur fond de croyance ? Ce qui naguère était une provocation aux yeux d’une histoire des sciences peu disposée à reconnaître à la croyance d’autres statuts que ceux de vestige et de symptôme d’un âge et d’une mentalité précritiques.
11inscription des savoirsvisualisationvisualisation de l’informationcarte matérialité des savoirssupportinfrastructure numériqueInternetMême attention à l’intercommunication chez V. Paravel quand elle scrute le présent de l’Internet, précisément, et son incidence sur un travail d’équipe comme celui, à l’IINSERM, du « réseau international du registre des cardiopathies ischémiques ». Elle dessine la carte où ce réseau s’inscrit : elle nous le montre piloté de Genève, appuyé sur des codages opérés à Glasgow et articulant en France trois pôles (Lille, Strasbourg, Toulouse) dont Paris se charge de centraliser les données, transmises ensuite pour analyse à Helsinki via « l’e-mail international », cet « instrument capable de faire transiter tout un monde ». D’où une nouvelle façon pour les chercheurs « d’enregistrer et de partager le savoir, d’interagir entre eux et avec lui ». Ainsi encore de cette « arène de discussions » qu’est le forum, « lieu-carrefour qui fait frontière entre ses membres, mais où chacun s’y retrouve, placé à l’intersection de différents “mondes sociaux interconnectés” ». Une « identité commune » peut alors se forger, « faite de grandes interactions entre des altérités qui se soudent en un “nous” de circonstance, un “nous” en suspens1 ».
12Si, dans Internet, V. Paravel valorise inter-, elle met en garde contre ce que pourrait avoir de trompeur le second composant, cette « figure du réseau, infiniment labile, qui dissout toute idée d’accumulation et de stabilisation possibles ». À l’encontre d’une « lecture purement connexionniste où tout circulerait en boucle et ne renverrait qu’à un monde en vase clos », elle voit « des collectifs d’acteurs prendre forme, et des objets de savoir se stabiliser » ; car, même quand il s’agit de « collectifs en suspens » et de « figures à géométrie variable », « ces espaces d’interaction ne charrient pas que des flux où tout ce qui prendrait forme se diluerait » : grâce à eux, grâce à cette « ténacité » qui « fait des écrits électroniques un puissant instrument de mémoire », se constituent aussi des « bassins référentiels », « lieux d’une histoire où s’entreposent, strates après strates, les gisements des connaissances collectives ». Du moins peut-on se féliciter qu’il y ait « porosité des lieux » plutôt que clôture, « flexibilité » non exclusive de structuration, « souplesse de mises en forme gérables sur des échelles très larges ». Pour autant, il ne faut pas se cacher que, sur ce terrain où les « intérêts » en présence sont nombreux, des guerres se déclenchent ou se poursuivent, si bien que « les tribunes électroniques donnent à voir un long déploiement de frontières, entre collaboration et compétition, entre appartenances multiples et replis disciplinaires », etc.
13Reste que, dans intérêt aussi, il y a inter-, signifiant initialement que l’on « participe à » (interesse), puis le « dédommagement pour une atteinte à quelque chose qui importe (interest) », et finalement « ce qui importe ». Mais, d’un progrès technique comme tel, si révolutionnaire soit-il, on ne saurait attendre qu’il concilie comme par enchantement le désintéressement (supposé) des scientifiques et les multiples intérêts plus ou moins divergents, et même contradictoires, qui meuvent les politiques2. Ce qui s’ensuit bien plutôt comme tensions trouve en tout cas à s’exprimer dans les variations que connaît la dynamique des savoirs, et des collectifs qui les gèrent : ce sont ces variations que le titre du présent texte entendait évoquer en parlant (d’après C. Bonnet et V. Paravel) d’« épaisseur » et de « fluidité ». Non pour affecter à chacun de ces termes une valeur constante, positive ou négative, mais parce que différentes configurations se dessinent en fonction des dosages et des passages entre ces contraires. On comprend dès lors que, pour interpréter et apprécier ces configurations, et telles notamment qu’on va les voir exposées dans ce chapitre, il ait fallu à chaque fois une perception fine et une analyse spécifique des lieux et des temps.
Les termes soulignés dans les citations le sont par moi (de même ci-après).
Voir Jürgen Habermas, Connaissance et intérêt, Paris, 1979.